L’ébauche
écrit par Simon Tarsier
publié le 19 décembre 2022
Ces textes ont été publiés dans le livre L’empreinte, photographies d’Emmanuel Veneau, textes de Simon Tarsier, édité par l’Attraction Céleste, 88p., 2023.
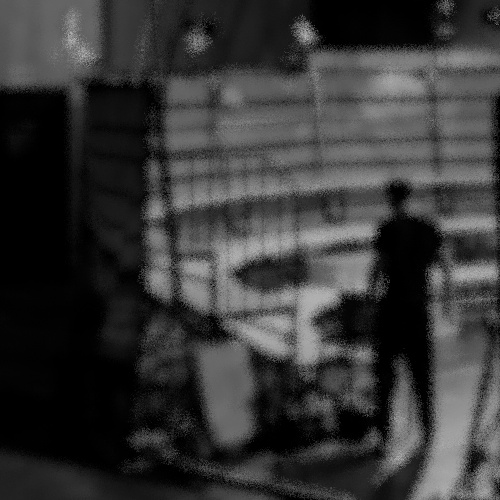
L’entonnoir
Portail ouvert au numéro 15. Passage ombragé. Petite table extérieure, au-delà une citerne, des tuteurs suggèrent ce qui doit être un potager. On bifurque à gauche vers un grand jardin. Chemins d’herbe fauchée. Partout, surgissantes des îlots restés en herbes sauvages, des fleurs mauves, élancées (ail des ours ?). Un vélo. Une caravane. Une bâtisse en bois. On en fait le tour, mais on ne voit que soi. Et tous les recoins du ciel. Reflétés par les vitres.
On entre. Une sorte d’atelier. Paraît exigu tant il est foisonnant. Tant le regard ne sait que voir. Des étagères comme une mémoire pleine à craquer de souvenirs juxtaposés. Cartons, pendule, bocaux, petits tiroirs à vis, clous et petites quincailleries, diluants, outillage à enduit, joints d’isolation, ampoules et pieds de lampes, peintures, ciseaux, perceuses, visseuses, vernis, valises, valisettes, boîtes et mallettes, paquets, morceaux de métal, de plastique, boîtes à café, souffleur chauffant. Et cet inventaire infini ruisselle jusqu’aux tables et plans de travail. Marteaux, pinces, cutter, bouchons, stylos bic, mèches, piques en bois, pinces à linge, tiges en métal, capsules, boules en liège, sécateur, tasseaux de bois. Jusqu’à une armature posée en équilibre, une intention qui se structure, émerge de toutes les alternatives restées spéculations, sauvée du chaos. Jusqu’à ces silhouettes saisies par l’étau, dansantes déjà, une pensée suspendue, surprise, mais qui promet la prochaine valse.
Au seuil, en comparaison, la pièce paraît immense, vide presque. Au seuil, on sent que c’est un espace hiératique et qu’on risque d’y choir, ou dans le meilleur des cas d’y trébucher en tentant une traversée maladroite. Alors, au seuil, on se raccroche à ce qu’on connaît, à ce qui s’y prolonge de l’atelier. Des chaussures. Un carton de rangement où des yeux ont été dessinés. Sur l’établi, une panière qui déborde d’instruments de musique. Tasses à café. Entonnoir. Plumes. Boîtes à chaussures. Carnets à spirales. Gobelets en plastique. Croquis, listes, notes, partitions. Paire de lunettes. Bobines et ciseaux. Bille. Ruban isolant. Fouets de cuisine. Chiffons. Plus loin, un escabeau comme un jalon dans l’espace suggérant une diagonale envisageable. On se retourne vers le reste de l’espace, on se rassure d’un coup d’œil en dénombrant ce qui fera limites (pieds de micro, teintures noires, radiateur, structure du toit).
L’espace, vous l’occupez déjà. Pieds nus sur le plancher, première piste pour les corps ; des indices, un cahier avec quelques textes déjà. La lumière vient de derrière vos visages, vos yeux dans l’ombre ponctuent des traits ramassés, concentrés. Déjà quelque chose palpite au milieu. La musique. Clarinette basse, accordéon. Le chant. Au commencement était la mélodie qui tenait lieu de monde entre vous. Les visages restent en partie dans l’ombre. Difficile de décrire un visage qui chante. Bouche/yeux. Les traits sont occupés à autre chose qu’à se donner à voir. La mélodie tourne, se cherche, se reprend, s’essaye à nouveau, se déplace, se prolonge, se cherche toujours et tourne une fois encore. Sol mineur. Fa dièse. Pied levé pour indiquer une dernière reprise des mesures. Silence.
Silence. Déjà vos regards dialoguent plus que vos mots.
Maintenant : garder traces.
Le temps des ébauches
Au commencement ça ressemble à l’enfance. Aux temps longs de l’enfance. Quand il n’y avait rien d’autre à faire que d’observer les adultes agir de leurs manières d’adultes. Quand le temps jouait pour nous. Quand mal réveillés, la lumière du matin se posait sur les gestes sans mots des gens qui prenaient soin de nous. On ne saisissait pas toujours le sens, l’intention de tous ces gestes, mais on percevait leur importance.
Au commencement, on dirait un jeu. Ils semblent accumuler autour d’eux des petits objets que je ne saurais décrire tant j’en perçois peu l’origine, ni l’usage, ni la destination. Ils les manipulent : tordent, ajustent, positionnent et recommencent souvent. Les phrases prononcées sont sans conséquences, accompagnent les mouvements des mains, des doigts. Je n’en ai rien retenu mais je me souviens des gestes. Les paroles n’ont d’autre grandeur que la nécessité des mains. Et puis ils s’arrêtent, tentent de raconter des bribes d’histoires qu’ils aimeraient voir vivre mais dont ils n’ont que des petits bouts, même pas des morceaux, juste la possibilité d’un commencement.
Alors ils se taisent. Ils vont jusqu’à la maison chercher un café ou saisissent un instrument de musique et tout se résout. Au commencement était la mélodie et la mélodie était l’accord du monde au milieu d’eux. Et la mélodie portait l’empreinte et ils l’habitèrent de leurs corps. L’esquisse de leurs corps dans l’espace, un mouvement qui donne, un geste qui s’inquiète de l’autre, un bras qui retombe, ballant, et dit son impuissance, le renoncement. Ils s’ébauchent, pensent tenir le fil, l’emmêlent. Les mains s’agitent encore ; la manière va sortir (cela ne fait aucun doute) de l’objet. Qu’ils retournent. Et pour moi, l’évidence que le commencement n’a pu venir que de leurs mains.
Ils nomment le chemin, re-déroulent le fil, disent les pas devant soi, les contenances des ombres qu’il faudra laisser à la nuit – au début, du moins –, la traverse qui les invite à ne pas suivre le chemin tel qu’il est écrit sur le carnet posé au sol.
Et puis la réalité se fait plus précise : quel engrenage pour faire danser nos silhouettes ?
[Plus tard.]
Lui, est allongé près de la tenture, yeux fermés. Elle, a passé sa robe de scène, fait de petits gestes de la paume de la main pour lisser le tissu, se considère dans le miroir, posément, et semble satisfaite du travail effectué, c’est tout-à-fait ce qu’elle imaginait, dit-elle pour elle-même. Lui, comme gisant, ses galoches de spectacle l’attendent sans impatience. Elle, se maquille. C’est un dialogue intérieur, une négociation muette de la main au visage, pour déterminer ce qui devra paraître aux yeux de tous. Il suffirait d’un trait un peu plus appuyé, ou prolongé, pour que celle qui émerge ne soit plus tout-à-fait la même, sans être tout-à-fait une autre. Lui, toujours allongé, immobile, s’enfonce un peu plus dans le sol, semble incurver le plancher et réinventer une géométrie locale de l’espace. La respiration seule vient maintenir à la surface, à fleur de plancher, un corps d’une infinie densité. Elle, termine son maquillage. En définitive, le regard en était le pivot. Il n’a pas varié. Il est toujours là, garant de la sincérité de ce qui s’apprête à se jouer. Le regard donne les dernières consignes, confie au visage, apprêté, les ultimes conseils. Le regard précise ce qui divague de l’âme, il sait la fin, le regard, il connaît les fils, les ressorts de l’histoire, le canevas qu’il faudra parcourir. Lui, a disparu de la surface du monde : sous la respiration, une béance. Il est allé chercher celui qu’il sera dans quelques instants, qui lui ressemblera comme un frère, qui sera vêtu d’ombres grandissantes, qu’il ne sortira du crépuscule, qu’il ne confiera à la lumière que pour mieux retracer son obscurcissement. Pour l’instant, il l’esquisse, il l’invoque en lui-même, il l’appelle par son nom secret, l’attend au point de rendez-vous fixé par les peurs et les déraisons, situé très en-deça des surfaces sensibles du monde, du corps. L’attendre, le reconnaître, s’en faire éprouver, l’accueillir comme son semblable, le prendre dans ses bras, lui saisir la main pour remonter, puis rouvrir les yeux et n’être plus tout-à-fait le même, ni tout-à-fait un autre. Enfiler ses chaussures, voilà ce qui reste à faire. Elle, s’approche de la fenêtre, s’inquiète un peu de l’organisation, écarte légèrement le rideau de tulle blanche, voit que les proches sont venus, ne s’inquiète plus. Lui, se redresse, assis, jambes écartées, mains sur les cuisses, envisage les chaussures délacées. Elle, sur le pas de la porte, mains croisées dans le dos, regard vers l’extérieur. Lui, lace ses chaussures. Méticuleusement.
Instruments de musique et bricolages foutraques font un décors précaire.
Ils se rejoignent. Ils se regardent. Ils se rassemblent. Ils s’entretissent. Ils s’entrecroisent jusqu’au bout des doigts et c’est l’âme des commencements qui retient son souffle pour mieux les embrasser.
Ils sortent.
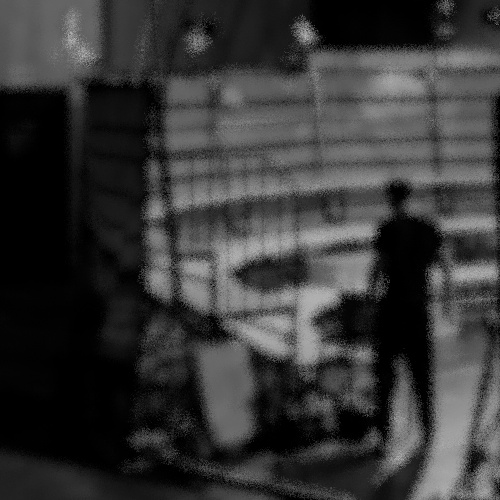
L’ébauche
écrit par Simon Tarsier
publié le 19 décembre 2022
L’entonnoir
Portail ouvert au numéro 15. Passage ombragé. Petite table extérieure, au-delà une citerne, des tuteurs suggèrent ce qui doit être un potager. On bifurque à gauche vers un grand jardin. Chemins d’herbe fauchée. Partout, surgissantes des îlots restés en herbes sauvages, des fleurs mauves, élancées (ail des ours ?). Un vélo. Une caravane. Une bâtisse en bois. On en fait le tour, mais on ne voit que soi. Et tous les recoins du ciel. Reflétés par les vitres.
On entre. Une sorte d’atelier. Paraît exigu tant il est foisonnant. Tant le regard ne sait que voir. Des étagères comme une mémoire pleine à craquer de souvenirs juxtaposés. Cartons, pendule, bocaux, petits tiroirs à vis, clous et petites quincailleries, diluants, outillage à enduit, joints d’isolation, ampoules et pieds de lampes, peintures, ciseaux, perceuses, visseuses, vernis, valises, valisettes, boîtes et mallettes, paquets, morceaux de métal, de plastique, boîtes à café, souffleur chauffant. Et cet inventaire infini ruisselle jusqu’aux tables et plans de travail. Marteaux, pinces, cutter, bouchons, stylos bic, mèches, piques en bois, pinces à linge, tiges en métal, capsules, boules en liège, sécateur, tasseaux de bois. Jusqu’à une armature posée en équilibre, une intention qui se structure, émerge de toutes les alternatives restées spéculations, sauvée du chaos. Jusqu’à ces silhouettes saisies par l’étau, dansantes déjà, une pensée suspendue, surprise, mais qui promet la prochaine valse.
Au seuil, en comparaison, la pièce paraît immense, vide presque. Au seuil, on sent que c’est un espace hiératique et qu’on risque d’y choir, ou dans le meilleur des cas d’y trébucher en tentant une traversée maladroite. Alors, au seuil, on se raccroche à ce qu’on connaît, à ce qui s’y prolonge de l’atelier. Des chaussures. Un carton de rangement où des yeux ont été dessinés. Sur l’établi, une panière qui déborde d’instruments de musique. Tasses à café. Entonnoir. Plumes. Boîtes à chaussures. Carnets à spirales. Gobelets en plastique. Croquis, listes, notes, partitions. Paire de lunettes. Bobines et ciseaux. Bille. Ruban isolant. Fouets de cuisine. Chiffons. Plus loin, un escabeau comme un jalon dans l’espace suggérant une diagonale envisageable. On se retourne vers le reste de l’espace, on se rassure d’un coup d’œil en dénombrant ce qui fera limites (pieds de micro, teintures noires, radiateur, structure du toit).
L’espace, vous l’occupez déjà. Pieds nus sur le plancher, première piste pour les corps ; des indices, un cahier avec quelques textes déjà. La lumière vient de derrière vos visages, vos yeux dans l’ombre ponctuent des traits ramassés, concentrés. Déjà quelque chose palpite au milieu. La musique. Clarinette basse, accordéon. Le chant. Au commencement était la mélodie qui tenait lieu de monde entre vous. Les visages restent en partie dans l’ombre. Difficile de décrire un visage qui chante. Bouche/yeux. Les traits sont occupés à autre chose qu’à se donner à voir. La mélodie tourne, se cherche, se reprend, s’essaye à nouveau, se déplace, se prolonge, se cherche toujours et tourne une fois encore. Sol mineur. Fa dièse. Pied levé pour indiquer une dernière reprise des mesures. Silence.
Silence. Déjà vos regards dialoguent plus que vos mots.
Maintenant : garder traces.
Le temps des ébauches
Au commencement ça ressemble à l’enfance. Aux temps longs de l’enfance. Quand il n’y avait rien d’autre à faire que d’observer les adultes agir de leurs manières d’adultes. Quand le temps jouait pour nous. Quand mal réveillés, la lumière du matin se posait sur les gestes sans mots des gens qui prenaient soin de nous. On ne saisissait pas toujours le sens, l’intention de tous ces gestes, mais on percevait leur importance.
Au commencement, on dirait un jeu. Ils semblent accumuler autour d’eux des petits objets que je ne saurais décrire tant j’en perçois peu l’origine, ni l’usage, ni la destination. Ils les manipulent : tordent, ajustent, positionnent et recommencent souvent. Les phrases prononcées sont sans conséquences, accompagnent les mouvements des mains, des doigts. Je n’en ai rien retenu mais je me souviens des gestes. Les paroles n’ont d’autre grandeur que la nécessité des mains. Et puis ils s’arrêtent, tentent de raconter des bribes d’histoires qu’ils aimeraient voir vivre mais dont ils n’ont que des petits bouts, même pas des morceaux, juste la possibilité d’un commencement.
Alors ils se taisent. Ils vont jusqu’à la maison chercher un café ou saisissent un instrument de musique et tout se résout. Au commencement était la mélodie et la mélodie était l’accord du monde au milieu d’eux. Et la mélodie portait l’empreinte et ils l’habitèrent de leurs corps. L’esquisse de leurs corps dans l’espace, un mouvement qui donne, un geste qui s’inquiète de l’autre, un bras qui retombe, ballant, et dit son impuissance, le renoncement. Ils s’ébauchent, pensent tenir le fil, l’emmêlent. Les mains s’agitent encore ; la manière va sortir (cela ne fait aucun doute) de l’objet. Qu’ils retournent. Et pour moi, l’évidence que le commencement n’a pu venir que de leurs mains.
Ils nomment le chemin, re-déroulent le fil, disent les pas devant soi, les contenances des ombres qu’il faudra laisser à la nuit – au début, du moins –, la traverse qui les invite à ne pas suivre le chemin tel qu’il est écrit sur le carnet posé au sol.
Et puis la réalité se fait plus précise : quel engrenage pour faire danser nos silhouettes ?
[Plus tard.]
Lui, est allongé près de la tenture, yeux fermés. Elle, a passé sa robe de scène, fait de petits gestes de la paume de la main pour lisser le tissu, se considère dans le miroir, posément, et semble satisfaite du travail effectué, c’est tout-à-fait ce qu’elle imaginait, dit-elle pour elle-même. Lui, comme gisant, ses galoches de spectacle l’attendent sans impatience. Elle, se maquille. C’est un dialogue intérieur, une négociation muette de la main au visage, pour déterminer ce qui devra paraître aux yeux de tous. Il suffirait d’un trait un peu plus appuyé, ou prolongé, pour que celle qui émerge ne soit plus tout-à-fait la même, sans être tout-à-fait une autre. Lui, toujours allongé, immobile, s’enfonce un peu plus dans le sol, semble incurver le plancher et réinventer une géométrie locale de l’espace. La respiration seule vient maintenir à la surface, à fleur de plancher, un corps d’une infinie densité. Elle, termine son maquillage. En définitive, le regard en était le pivot. Il n’a pas varié. Il est toujours là, garant de la sincérité de ce qui s’apprête à se jouer. Le regard donne les dernières consignes, confie au visage, apprêté, les ultimes conseils. Le regard précise ce qui divague de l’âme, il sait la fin, le regard, il connaît les fils, les ressorts de l’histoire, le canevas qu’il faudra parcourir. Lui, a disparu de la surface du monde : sous la respiration, une béance. Il est allé chercher celui qu’il sera dans quelques instants, qui lui ressemblera comme un frère, qui sera vêtu d’ombres grandissantes, qu’il ne sortira du crépuscule, qu’il ne confiera à la lumière que pour mieux retracer son obscurcissement. Pour l’instant, il l’esquisse, il l’invoque en lui-même, il l’appelle par son nom secret, l’attend au point de rendez-vous fixé par les peurs et les déraisons, situé très en-deça des surfaces sensibles du monde, du corps. L’attendre, le reconnaître, s’en faire éprouver, l’accueillir comme son semblable, le prendre dans ses bras, lui saisir la main pour remonter, puis rouvrir les yeux et n’être plus tout-à-fait le même, ni tout-à-fait un autre. Enfiler ses chaussures, voilà ce qui reste à faire. Elle, s’approche de la fenêtre, s’inquiète un peu de l’organisation, écarte légèrement le rideau de tulle blanche, voit que les proches sont venus, ne s’inquiète plus. Lui, se redresse, assis, jambes écartées, mains sur les cuisses, envisage les chaussures délacées. Elle, sur le pas de la porte, mains croisées dans le dos, regard vers l’extérieur. Lui, lace ses chaussures. Méticuleusement.
Instruments de musique et bricolages foutraques font un décors précaire.
Ils se rejoignent. Ils se regardent. Ils se rassemblent. Ils s’entretissent. Ils s’entrecroisent jusqu’au bout des doigts et c’est l’âme des commencements qui retient son souffle pour mieux les embrasser.
Ils sortent.
Ces textes ont été publiés dans le livre L’empreinte, photographies d’Emmanuel Veneau, textes de Simon Tarsier, édité par l’Attraction Céleste, 88p., 2023.